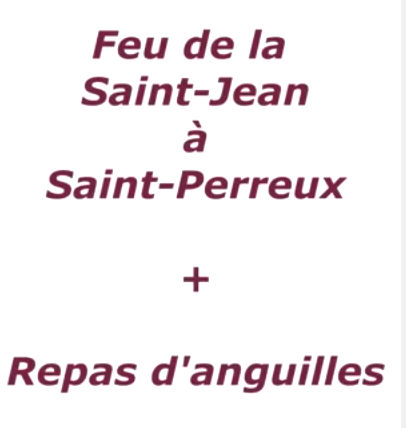Dessin d'Eugène Martin -
1868 (Musée breton, Quimper)
Les origines de la Fête de
la Saint-Jean restent floues.
Célébrée le jour symbolique
du solstice d’été, pendant la nuit la plus courte de
l’année, la fête de la Saint-Jean consistait dans l’antiquité
à allumer un grand feu qui avait, disait-on, un pouvoir
purificateur. On a aussi donné à ce rituel le pouvoir
de bénédiction des moissons, de la fertilité et de
l’abondance.
A Plozévet, au cours des années 60, la fête de la Saint-Jean
est devenue de plus en plus discrète. Certains tentent encore,
ici et là, de la faire revivre mais plus rien n'est spontané.
On ne fait plus le fête , on y assiste. (voir dernier
paragraphe)
En juin 1899 le journal
« Le Finistère » évoquait les feux de la St-Jean
qui rassemblaient encore les habitants des campagnes pour
une fête champêtre qui avait ses rites :
«Suivant une vieille
coutume encore répandue partout et à laquelle la Bretagne
est restée particulièrement attachée, nous avons vu hier
au soir briller de tous côtés les feux de la Saint-Jean.
Ce sont là les feux de joie de tous nos paysans qui fêtent
en cette occasion les prochaines moissons et demandent au
saint favori du Paradis de les rendre plus amples et plus
riches. De toutes les anciennes coutumes bretonnes, celle
là est peut-être l'une de celles qui ont conservé le plus
de faveur. Comme au temps des ancêtres, on voit encore
notre yaouankis danser en rond pendant que crépite le
brasier allume par le plus ancien du village. Chacun a
contribué à cette fête en portant un fagot pour le feu de
la St-Jean, jusqu'au malheureux, qui, lui-même arraché aux
épines et aux ronces du chemin un faix de brindilles qui
grossira le tas déjà préparé par les métayers.
Bientôt les flammes
tombent, presque tout est consumé, mais avant de quitter
l'aire, les potred, en un tournoi rustique, franchissent
d'un saut, à tour de rôle le brasier encore fumant, sous
le regard encourageant de la pennerez qu'enorgueuillissent
toujours les prouesses du préféré.
Mais il n'est plaisir
qui dure. Des tisons qui restent, chacun emporte
religieusement le sien, pour le placer au foyer du logis
qu'il préservera de tout maléfice.
Le lendemain, au petit
jour, le pauvre vient aussi recueillir sa part. Il ramasse
les cendres qu'il vendra un peu plus cher que les cendres
ordinaires. Les cendre de la Saint-Jean n'ont-elles pas
des vertus plus précieuses que celles de l'âtre ou du
four ? Le champ qui les aura reçues ; mieux
fécondé par leur potasse bénite, portera l'année suivante
une plante plus belle : la plante de l'illusion
toujours germante et toujours plus chère au cœur de
l'homme, qu'il soit de Bretagne ou de Dauphiné. »
Quelques
années plus tôt , en 1893, dans « La Légende de la
mort en Basse-Bretagne », Anatole Le Braz écrivait
aussi :
«La nuit de la
Saint-Jean, dans tous les bourgs, dans tous les hameaux de
la Basse-Bretagne, s’allument les''tantad''ou bûchers.
Quand le feu a fini de flamber, l’assistance s’agenouille
en cercle autour du monceau de braise. Et l’on commence à
réciter les grâces. C’est toujours un «ancien» qui se
charge de ce soin. La prière terminée, l’ancien se lève,
chacun en fait autant, et tout le monde, rangé sur une
file, se met à marcher en silence autour du tantad. Au
troisième tour, on s’arrête. Chacun ramasse à terre un
caillou, et le jette dans le feu. Ce caillou s’appelle dès
lors: Anaon.
Ce rite accompli, la foule se disperse.
Dès que les vivants ont disparu, les morts
accourent, car le feu attire les morts, les morts qui ont
toujours froid, même dans les belles nuits tièdes du mois
de juin. Ils sont heureux de pouvoir se chauffer à ce qui
reste du tantad. Ils s’asseyent sur les pierres, sur les
anaon qui ont été mis là à leur intention. Et jusqu’au
matin ils se chauffent.
Le lendemain, les vivants viennent visiter
l’emplacement du feu de la veille. Celui
dont l’anaon a été retourné peut s’attendre à mourir dans
l’année. »
 « Le Petit
Journal » du 1er Juillet 1893 : (Photo extraite de
la première page. )
|
Dans « Le cheval
d'orgueil », Pierre Jakez Hélias évoque, lui aussi, la fête de
la St-Jean de son enfance à Plozévet et à Pouldreuzic:
« Celle là, malgré le
nom de l'apôtre, on se demande si elle n'a pas un peu l'odeur
du diable.
Il semble bien que le clergé ne la voit pas d'un bon
œil. D'ailleurs ce n'est pas une fête paroissiale mais
réjouissance des quartiers. Il y a rivalité entre les
quartiers, chacun tâchant d'avoir le plus beau feu et le plus
durable. […]
Le feu est allumé par des spécialistes qui ne
laisseraient le soin à personne d 'autre. Ils le font flamber
le plus haut et le plus clair possible, y ajoutant de temps en
temps de la bouse de vache séchée […] Quand les flammes sont
tombées, les plus audacieux sautent par dessus le lit de
braises rougeoyantes. Certains s'en brûlent un peu la plante,
ils n'en sont que plus farauds.
Déjà les jeunes filles
commencent à se cacher derrière leurs mères car tout à l'heure
les garçons vont s'emparer d'elles, les prenant les uns sous les
aisselles, les autres sous les genoux pour les balancer à neuf
reprises par dessus les braises (cela s'appelle ober ar wakel).
[...] En certains endroits on vend les cendres aux
enchères au profit de St Jean. Elles fertilisent les champs. Je
ne le vois pas faire mais je vois les gens emporter des cendres
dans un pochon ou dans un sabot.
Pour la chance, disent-ils.»
Dans
son « Journal de Plozévet », en 1965, Edgar Morin
pose un regard critique très négatif sur un moment qu'il a
vécu autour d'un feu:
«Tous demandent à
s'amuser, à être gais et, profondément, à communiquer autour
du feu. Mais ils n'y arrivent pas. Les groupes ne se fondent
que sporadiquement dans un ''nous'', chacun se trouvant très
vite à part, en soi. Chaque sous-groupe, notamment celui des
jeunes, est intimidé par la présence des autres.
Le feu des âmes est
mouillé. [...]
Ce feu est sans feu. Il vit à l'état de réflexe
mécanique. Ce sont des automatismes privés du suc des
croyances, privés de leur force mythologique. On ne songe même
pas à la coïncidence entre le feu et le solstice de juin, la
naissance de l'été. »
|

|
|
Nous
terminerons par les mots de Fanch Postic , ingénieur d'étude
au CNRS :
«La St-Jean était fêtée le 23
juin au soir. Désormais, elle est fêtée lors du week-end le plus
proche, voire parfois au début de juillet, pour attendre l'
arrivée des premiers touristes. […]
Les liens distendus avec le religieux modifient aussi le contenu
des fêtes qui n'ont plus les mêmes significations et les mêmes
fonctions. La fête de la St-Jean avait, en Bretagne, une
importance équivalente à celle de la Toussaint, elle possédait
certes un lien fort avec la période agricole mais était aussi un
hommage rendu aux morts.
Aujourd'hui, la Saint-Jean constitue davantage un prétexte à des
animations festives, sans connotation religieuse.»
|